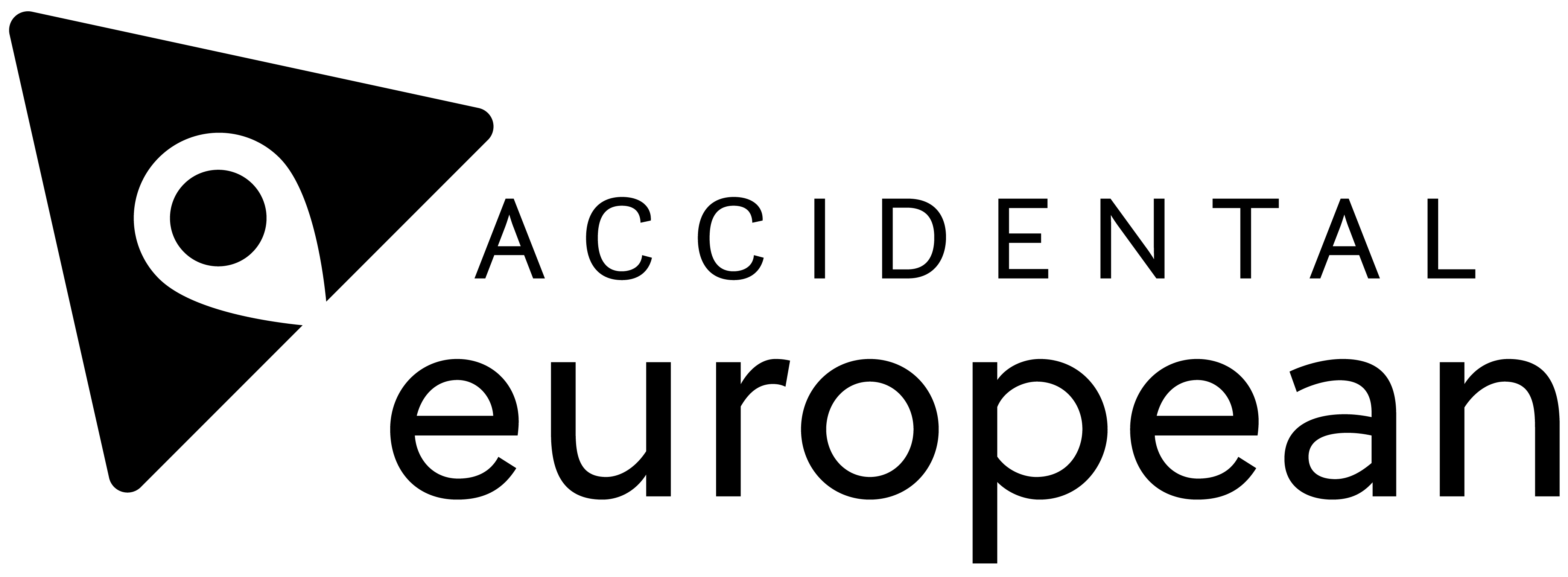“Non seulement il est mignon, mais en plus il est passé par Yale ? Tu devrais foncer.” Je me trouvais alors à l’extérieur d’un bar à vin par un rare après-midi ensoleillé dans le Sud de Londres, écoutant un ami me parler de son intérêt pour un homme qu’il avait rencontré en soirée. Était-il attirant ? Assez clairement, d’après ses photos instagram. Mais une personnalité agréable ? Et diplômé de l’Ivy League ? “On dirait que tu as touché le jackpot.”
Nous swipons à droite si rapidement, sans nous rendre compte qu’il s’agit d’un classisme inconscient. Nous avons été conditionnés à évaluer rapidement les gens selon leur apparence, leur richesse et leur statut social. Cela ne prend que quelques secondes, surtout dans les milieux urbains et professionnels. C’est l’aura nébuleuse et subtile d’estime qui s’attache à une éducation d’élite. Nous croyons à l’histoire qui veut que les marques académiques de haut niveau soient synonymes d’intelligence et de succès – un pas important dans la trajectoire d’une vie ayant “de la valeur”. Éducation, maison, mariage, et enfants.
Daniel Markovits est à l’origine de l’expression “fausses promesses méritocratiques” – décrivant le mythe qui veut que notre système académique moderne octroie des récompenses à ceux qui travaillent dur, et que la réussite scolaire soit un bon baromètre du mérite individuel d’une personne.
Mais comment en sommes-nous arrivés là ? Sommes nous, en tant que société, responsables de la perpétuation de cette idée ? Sommes-nous capables d’imaginer un monde sans ce faux-semblant ? La recherche des réponses à ces questions fascine les chercheurs en sciences sociales. Je crois que les gouvernements occidentaux modernes, y compris l’UE, ont joué un rôle majeur dans le maintien de ce lien, souvent au détriment de la cohésion sociale.
La lune de miel est finie
Nous sommes persuadés que notre histoire est différente, et que les systèmes démocratiques sont la référence absolue en termes de société. Lorsque des violations des droits de l’homme éclatent au grand jour dans des pays dirigés par un parti unique ou un régime autocratique – comme les camps de concentration Ouïghours en Chine et le génocide des Rohingyas au Myanmar – nous sommes nombreux, à l’Ouest, à nous assurer que de telles choses ne pourraient jamais nous arriver. Tandis que les dictateurs réduisent les alternatives à leurs régimes au silence (à l’image du traitement de Nalvany par Poutine), les démocraties équilibrées leur accordent le droit de réunion, une couverture médiatique, voire des positions fantômes au sein de leurs gouvernements (le cabinet fantôme est une pratique dans l’opposition au Royaume Uni N.D.R.L.).
Les dictatures modernes représentent une nouvelle incarnation des lignées royales, dans lesquelles les dirigeants actuels sélectionnent et forment les dirigeants de demain selon leur proximité et leur statut, favorisant leurs alliés. Les démocraties, en revanche, promettent un environnement dans lequel le pouvoir politique et économique peut être conquis par des personnes talentueuses, qui émergent souvent d’endroits inattendus. Le gentil peut gagner, ce qu’il fait souvent. Joe Biden, le président des Etats-Unis, est un bon exemple de ce concept. Né à Scranton, en Pennsylvanie – une ville dont la médiocrité est passée à la postérité lorsqu’elle a été choisie comme cadre pour la version américaine de The Office – le père de Joe était un vendeur de voitures d’occasion.
Cette histoire de réussite fulgurante, dans laquelle le talent se transforme en célébrité, représente peut-être la notion la plus fondamentale de la culture occidentale axée sur l’individu. C’est le scénario préféré de l’ensemble du spectre politique.
Evoquant un souvenir d’enfance, Lloyd Blanfein, l’ancien directeur général de Goldman Sachs, disait ainsi : “Lorsque j’allais à l’école, je ne pouvais pas aller aux toilettes, parce que j’avais peur de me faire poignarder. Je n’avais pas l’air conditionné non plus”. Mais nous entendons sans cesse dire que le talent d’un individu est capable de briller à travers toutes les saletés qui ont été placées en travers de son chemin. Justice sera rendue, à sa manière.
Ce n’est rien d’autre qu’un récit idéaliste qui continue à nous séduire.
L’éducation, le “grand égalisateur”
Lloyd Blankfein est passé des toilettes scabreuses de son école primaire de Brooklyn aux quadrilatères du Harvard College et de la Harvard Law School, avant d’arriver à Goldman Sachs, en passant par un grand cabinet d’avocats New-Yorkais.
En d’autres mots, notre méritocratie est une éducationocratie. Selon Payscale, les salaires en milieu de carrière des diplômés du MIT, de Stanford et de Harvard sont environ 33% plus élevés que ceux des diplômés de l’Université du Michigan (une université publique très réputée) et plus de 75 % plus élevés que ceux des diplômés d’une université publique de moins haut niveau comme SUNY New Paltz ou UNLV.
Les défenseurs de l’éducationocratie pointent du doigt les professions dans lesquelles l’éducation est un moteur évident de performances supérieures. Comme l’écrit le blogueur et psychiatre Scott Alexander :
L’intuition derrière la méritocratie est la suivante : si votre survie dépendait de la réussite d’une opération délicate, préféreriez-vous que l’hôpital embauche un chirurgien qui a réussi haut la main ses études de médecine ou un chirurgien qui a dû suivre une formation de rattrapage pour s’en sortir avec un C-? Si votre préférence va vers le premier, vous êtes un méritocrate en matière de chirurgiens. En généralisant un peu, vous aurez trouvé l’argument parfait pour appliquer cette vision méritocratique à toutes les situations.
Le véritable problème provient de cette “petite généralisation”. Le lien qui unit éducation et performance est-il aussi étroit pour les gestionnaires de fonds spéculatifs que pour les chirurgiens ? Qu’en est-il des entrepreneurs ou des avocats d’affaires ? Le succès dans ces professions dépend-il de capacités différentes de celles qui conduisent au succès académique ? Alexander lui-même présente un contre-argument à cette idée :
Ulysses Grant a obtenu son diplôme avec des résultats qui le plaçaient dans la moitié inférieure de sa classe à Point West, mais il s’est avéré être le seul homme capable d’égaler le général Lee et de gagner la guerre civile américaine après que toute une série de généraux superficiellement mieux qualifiés aient échoué. S’il existait un Grant des temps modernes avec des mauvaises notes mais d’excellentes capacités en terme de combat réel, sommes-nous certains que notre éducationocratie moderne serait capable de le trouver ? Sommes-nous certains qu’elle essaiera ?
Prenons un exemple tiré du lieu de travail classique. Un groupe de chercheurs a évalué les performances de plusieurs employés de bureau dans le cadre de projets de routine, en les évaluant sur leurs compétences techniques, leur capacité de leadership et la qualité des produits livrables. L’étude a révélé une légère amélioration des résultats de 1.9% pour chaque différence de 1000 positions dans le classement mondial des universités. Retranscrit avec les données de Payscale, cette différence minime en termes de résultats se traduirait par une différence de 96% dans les revenus en milieu de carrière.
Les temples modernes que sont Harvard et Oxford, Stanford et Cambridge, l’Ecole Normale Supérieure et l’Ecole Polytechnique, ne sont légitimes que dans la mesure où l’éducation est un critère de ce que nos sociétés jugent important. Nous devons nous défaire de cette notion.
Les éternels romantiques de l’éducation
Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission Européenne, a proclamé : “l’éducation est au cœur des sociétés européennes. Elle est indispensable à l’épanouissement personnel de chaque Européen.”
S’il est universellement admis que l’éducation sert “le plus grand bien”, il va de soi que la meilleure éducation équivaut à la plus grande vertu. Cet homme attirant diplômé de Yale dont nous avions parlé plus tôt ? Son diplôme signifie qu’il est capable de se concentrer sur ses objectifs et persévérant, sans rechercher les plaisirs à court terme. Cette idée présente des parallèles notables avec la notion de vertu religieuse.
Mais cette définition superficielle présente deux problèmes.
-
Les facteurs codés génétiquement
Dans son livre The Cult of Smart, Fredrik deBoer affirme que le discours contemporain sur l’éducation néglige le fait évident que l’héritage génétique d’un individu a une forte influence sur ses résultats scolaires. Selon deBoer, la nature capricieuse de cet héritage (personne ne “mérite” ses gènes) est le véritable problème de notre éducationocratie. Comment justifier moralement l’attribution d’une valeur aussi élevée aux résultats scolaires quand une telle chance est indispensable au succès ?
-
Le statut économique
Ce problème ne devrait être une surprise pour personne. Dans son livre The Meritocracy Trap, Daniel Markovits le résume de la manière suivante :
“De nos jours, les enfants issus de la classe moyenne sont perdants face à leurs camarades plus riches à l’école, et les adultes de la classe moyenne sont perdants face aux diplômés de l’élite au travail. La méritocratie empêche la classe moyenne d’accéder aux opportunités, puis rejette le blâme sur ceux qui se retrouvent perdant dans une compétition pour le revenu et le statut que, même lorsque personne ne triche, seuls les plus riches peuvent gagner”.
En bref, pour réussir, les enfants et les jeunes adultes doivent travailler dur, faire montre d’un talent intellectuel naturel, et avoir une famille qui les soutient émotionnellement et financièrement. Le pack complet. Réfléchissez un instant : combien de vos amis d’enfance réunissaient tous ces critères ? Sans doute un très petit nombre.
Lorsque nous attribuons l’idée de “mérite” à un étudiant qui réussit (tel qu’un diplômé de l’Ivy League ou “d’Oxbridge”), nous ignorons délibérément toutes les variables qui lui ont été attribuées par le hasard. Il est peut-être encore vrai que la réussite professionnelle individuelle signifie que cette personne possède la vertu d’une bonne éthique de travail. Mais il est également vrai que de nombreuses personnes dotées d’une éthique de travail tout aussi forte seront exclues de la course aux récompenses de l’éducationocratie à cause de facteurs qui échappent totalement à leur contrôle.
La proximité au succès et les filets de sécurité.
Il est temps que je me présente. Je suis le produit de deux des institutions universitaires les plus réputées au monde : Stanford et Oxford. Presque aucune des personnes avec lesquelles j’étais au lycée ne peut en dire autant. Mais comment cela se fait-il ? Si je devais gagner des milliards et me faire interviewer par le Sunday Times, le récit qui émergerait serait sans doute centré sur mon amour d’enfance (à la limite de l’obsession) des bibliothèques publiques ou sur mon choix d’étudier plutôt que de faire la fête.
Ces détails sont bien entendu réels, mais le récit public négligera de mentionner mes parents, tous les deux diplômés (et m’encourageant à obtenir de bons résultats scolaires), et ma capacité innée à obtenir de bons résultats aux tests standardisés (une pratique commune pour les examens dans le monde académique anglo-saxon N.D.R.L.)
Aucun de ces deux facteurs n’était mérités, ni même justes. Je les ai reçus de naissance. Voyez-vous comment mon profil était déjà construit, même à l’adolescence ?
Michael Young, un sociologue et politicien britannique, a utilisé pour la première fois le terme “méritocratie” dans sa satire dystopique publiée en 1958 et intitulée The Rise of the Meritocracy. Dans son livre, Young imagine une société dans laquelle le “mérite” est devenu le facteur principal d’organisation de la société, engendrant ainsi de nouvelles classes de nantis et de démunis (qui ne sont pas sans rappeler les hiérarchies liées à la fortune et au statut hérités). Bien plus tard, Young fut choqué de voir cette “méritocratie” exaltée comme une vertu par Tony Blair et le mouvement New Labour au Royaume-Uni au début du 21e siècle. Réagissant à cette évolution, Young écrivit les mots suivants :
Les aptitudes d’un genre conventionnel, qui étaient autrefois réparties plus ou moins au hasard entre les différentes classes, ont été bien plus fortement concentrées par le moteur de l’éducation. Une révolution sociale a été accomplie en assignant aux écoles et aux universités la tâche de trier les individus selon l’étroite fourchette des valeurs de l’éducation. Il est en effet difficile, dans une société qui produit tant de mérite, d’être jugé comme n’en ayant aucun. Aucune classe défavorisée n’a jamais été laissée aussi moralement dénudée que cela.
Young s’est rendu compte d’une évolution fondamentale qui sépare les classes défavorisées du passé et celle qui se forme aujourd’hui. Auparavant, le fait de vivre sans statut social ou moyens financiers signifiait uniquement que l’on était né dans une famille dépourvue de statut social ou de moyens financiers : il s’agissait d’un manque de chance, pas d’un verdict moral.
A l’inverse, ceux qui ne disposent pas de statut social ou de moyens économiques sont aujourd’hui privés non seulement d’opportunités, mais aussi d’un sentiment de vertu. Si cette soi-disant société méritocratique présente l’éducation comme un moyen d’avancement social, alors ceux qui ne peuvent pas avancer doivent porter la responsabilité de cet échec.
Cette illusion doit prendre fin. Nous nous sommes trop longtemps laissés séduire par les belles paroles de la méritocratie.
La méritocratie mise à nue
Que pouvons-nous faire à ce propos, alors que les institutions les plus respectées à travers le monde contrôlent cette idée ? Quel rôle nous incombe en tant qu’individus, et quel est celui des décideurs politiques et des politiciens européens ? La méritocratie a bien sa place dans nos sociétés, mais de manière bien plus restreinte que sa forme actuelle. Elle devrait devenir un personnage secondaire, pas une star.
Nous devons commencer par aborder le problème de l’éducation formelle, de son statut de vertu morale ou de fin en soi. L’éducation formelle, en tant que large concept sur les plateformes politiques, doit être démantelée avant de pouvoir être reconstruite avec une substance plus juste et utile.
Prenons l’exemple de la Déclaration de Porto au Sommet Social de Porto, auquel ont assisté des dirigeants et des institutions européennes, ainsi que des partenaires sociaux et des représentants de la société civile. Le point n°8 de la Déclaration de Porto affirme hardiment : “Nous placerons l’éducation et les compétences au cœur de notre action politique”. Cependant, le Plan d’Action pour le Pilier Européen des Droits Sociaux indique clairement que les mesures qui accompagnent cette déclaration sont dans l’ensemble consacrées à la mise en place de formations spécifiques permettant de développer les compétences requises par les nouvelles industries du futur, et non d’une éducation générale en soi.
Jusqu’à présent, le Plan d’Action n’attribue de valeur à l’éducation qu’en tant “qu’éducation et formation initiale” fournissant une “base solide de compétences de bases et transversales” qui permet aux adultes d’améliorer leurs compétences en suivant d’autres formations plus tard dans leur vie afin de s’adapter à un marché du travail en constante évolution.
Si le document détaillant les mesures envisagées indique clairement que l’objectif est de former, pourquoi le titre de la Déclaration de Porto commence-t-il par le mot “éducation”? Cette distinction est subtile mais cruciale. Le terme “formation” implique un objectif final spécifique. Il s’agit pour les travailleurs de développer ou d’accroître leurs compétences afin de s’adapter à l’évolution du marché du travail et aux nouvelles technologies. Une formation est spécifique, pratique, et représente un objectif parfaitement raisonnable pour la prise de nouvelles mesures.
A l’inverse, “l’éducation” est bien plus ouverte, et de nombreux parcours (peut-être presque tous) ne proposent pas d’objectif final spécifique. La glorification de l’éducation comme un objectif final idéal en soi, et la séparation de l’éducation et de la formation, est un terrain beaucoup plus obscur sur lequel établir une politique. Si l’enseignement primaire et secondaire permettent aux enfants d’acquérir des compétences sociales et pratiques dont l’importance est fondamentale, aussi bien à un niveau individuel ainsi que pour la cohésion sociale, que confère l’enseignement formel (supérieur) lorsqu’il est séparé des formations qui préparent à des professions spécifiques basées sur certaines compétences ? Souvent, pas grand chose, si ce n’est qu’il renforce l’attrait du profil des candidats.
Une éducation qui soit fidèle à tous.
Nous devons répondre à la question suivante : l’enseignement général supérieur peut-il être bénéfique à la société ? Y a-t-il quelque chose que nous apprécions davantage, en tant que société, que le fait de gagner de l’argent ? Et cela pourrait-il être rendu universellement accessible grâce au soutien du gouvernement ? C’est vers ces problématiques que les efforts politiques devraient être dirigés.
La France représente ici un cas d’étude utile. En avril, Emmanuel Macron a annoncé la fermeture de l’École Nationale d’Administration (ENA). Créée par Charles de Gaulle en 1945, l’ENA avait été fondée dans le but d’ouvrir l’accès aux échelons supérieurs de la fonction publique française – dont tous les ministères requéraient des examens compliqués nécessitant des connaissances approfondies et spécifiques, privilégiant les initiés.
L’ENA avait été conçue pour répondre à un idéal méritocratique en offrant des places de manière transparente, sur la base des seules notes obtenues aux examens, puis en donnant une formation générale en sciences sociales aux candidats retenus avant de les envoyer occuper des postes élevés dans la fonction publique.
C’est à première vue une excellente idée, n’est-ce pas ? Dans la pratique, cependant, ce système n’a fait que reproduire les structures de pouvoir existantes, dans lesquelles les candidats privilégiés (souvent riches, souvent blancs) obtiennent des places pour ensuite exercer une influence démesurée dans la fonction publique.
Au moment de l’annonce de la fermeture, au moins un parent de 70% des nouveaux élèves de l’ENA occupait un poste à responsabilité dans le monde des affaires ou dans la fonction publique.
Le successeur de l’ENA sera un “Institut de Service Public” avec un curriculum plus diversifié, un mécanisme de recrutement qui offrira davantage d’opportunités pour les candidats issus des couches les moins privilégiées de la société française (et marquera la fin du parcours-type “travail pour la vie” qui couvrait les diplômés de l’ENA du besoin de prouver leur aptitude pour des postes élevés).
Tout comme l’ENA, l’Institut de M. Macron pourrait tout à fait réussir pendant un certain temps à faire évoluer le profil de l’élite de la fonction publique. Mais ce changement sera-t-il assez radical pour durer sur le long terme ? J’en doute.
Tous les êtres humains méritent d’être aimés
Si nous souhaitons mettre fin aux problèmes qui remettent nos sociétés méritocratiques modernes en question, le modèle post-ENA de diversification, qui consiste simplement à ratisser plus large en termes d’origine socio-économique pour créer l’élite du futur, ne sera pas suffisant. L’amour existe même au-delà d’un rayon de 5-10km de l’élite.
Nous avons besoin d’une diversification qui soit plus profondément ancrée en dehors de l’éducationocratie elle-même.
Nous devons nous transformer et passer d’une société monothéiste, qui considère le succès scolaire comme l’unique chemin vers le succès, à une société polythéiste, au sein de laquelle des types innombrables de talent humain peuvent apporter de la valeur à nos communautés.
L’aube de l’ère de l’automatisation représente une occasion en or de nous diriger vers une réussite collective, qui touche chacun d’entre nous. Alors que l’automatisation s’immisce de plus en plus dans les domaines des travailleurs du savoir, il se peut que nous assistions à une renaissance de certains dons humains uniques (comme la créativité, l’empathie et la spiritualité) et à une augmentation de leur valeur marchande, directement liée à leur rareté relative.
Malgré tous ses défauts, la méritocratie est là pour de bon. Nous devons maintenant prendre un recul collectif et observer ce que nous avons créé. Il nous faut décider si notre système d’ascension méritocratique centrée sur l’éducation peut réellement discerner et récompenser le “bien” tel que nous aimerions le définir. Il se peut que nous découvrions que le fait d’offrir aux individus différents chemins vers le succès représente la meilleure façon de résoudre les problèmes d’aujourd’hui.
Pour rafraîchir l’interminable chasse aux titres. Pour écrire une nouvelle fin.